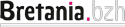L’honneur de celui qui reçoit est en jeu. C’est pourquoi le duc demande aux villes de seconder l’action ducale en recevant ses hôtes. Les autorités urbaines sont tenues à un certain nombre d’obligations concernant l’hospitalité des visiteurs. Les dépenses réalisées à ces occasions sont soigneusement consignées dans les comptes municipaux, appelés comptes des miseurs. Ceux de Rennes nous apportent ainsi de précieux renseignements sur les festivités organisées.
Le cérémonial d’accueil
L’arrivée d’un hôte de marque, souvent annoncée par les hérauts d’armes, est signe de fête pour la population qui assiste à sa «joyeuse venue». Des feux de joie sont allumés et des tonneaux de vin sont disposés sur les lieux de passage et aux principaux carrefours. Des musiciens et acrobates égayent la procession en ouvrant le passage aux invités.
 La ville prend en charge toutes les dépenses concernant la protection et le traitement du visiteur : frais d’escortes, de transport et de chevaux, cadeaux (argent, vaisselle, bijoux et autres objets de valeur), frais de logement, boisson, nourriture, nettoyage du linge, torches, bois de chauffage et bougies… Les bourgeois de Rennes s’occupent ainsi de fournir une escorte à l’ambassade anglaise conduite par Louis de Bretailles, émissaire du roi d’Angleterre Édouard IV, en 1475. Ils engagent aussi des hommes et des chevaux pour transporter « les coffres, malles et autres bagaiges dudit ambassadeur ». Du 2 au 5 mai, certains Anglais descendent chez l’habitant, d’autres à l’hôtel du Cheval Blanc ou chez l’hôtesse de La Gallée, des établissements de bonne réputation. Le conseil des bourgeois charge ensuite Allain Fortin, « trompette » de la ville, de conduire l’ambassade à Saint-Malo.
La ville prend en charge toutes les dépenses concernant la protection et le traitement du visiteur : frais d’escortes, de transport et de chevaux, cadeaux (argent, vaisselle, bijoux et autres objets de valeur), frais de logement, boisson, nourriture, nettoyage du linge, torches, bois de chauffage et bougies… Les bourgeois de Rennes s’occupent ainsi de fournir une escorte à l’ambassade anglaise conduite par Louis de Bretailles, émissaire du roi d’Angleterre Édouard IV, en 1475. Ils engagent aussi des hommes et des chevaux pour transporter « les coffres, malles et autres bagaiges dudit ambassadeur ». Du 2 au 5 mai, certains Anglais descendent chez l’habitant, d’autres à l’hôtel du Cheval Blanc ou chez l’hôtesse de La Gallée, des établissements de bonne réputation. Le conseil des bourgeois charge ensuite Allain Fortin, « trompette » de la ville, de conduire l’ambassade à Saint-Malo.
Un temps fort de la réception : le banquet
Du vin et des friandises sont apportés lors de la première rencontre, en signe de bienvenue, prélude aux banquets et fêtes des jours suivants. Une attention toute particulière est portée aux produits que l’on sert. On s’efforce de trouver du vin de qualité pour honorer ses hôtes. Il s’agit de vin « claret » ou de vin d’Anjou pour l’essentiel, du blanc ou du « vermeil », donné au repas ou comme « vin de couscher ». On considère en effet que le vin blanc ouvre les pores et les voies digestives tandis que le rouge les referme. On offre aussi du vin épicé, spécialement de l’hypocras, rouge ou blanc. Cette boisson est servie avant le repas, en guise d’apéritif, ou à la fin, lors de « l’issue ». Le service est assuré dans les plus grandes maisons par l’échansonnier. Le vin est ce qui coûte le plus cher dans un banquet et son prix augmente fortement à la fin du XVe siècle (une pipe de vin d’Anjou, en 1450, coûte 10 livres, 20 livres en 1488).
Toute réception digne de ce nom s’accompagne d’un banquet. Bien plus qu’un simple repas, il constitue un événement politique lors duquel le pouvoir se donne en représentation. Les banquets officiels organisés en l’honneur d’ambassades étrangères regroupent une assemblée nombreuse, composée en partie des membres de la suite, des notables de la ville et des représentants du pouvoir ducal. Celui organisé pour accueillir Jacques de Gondebaud, ambassadeur de Maximilien d’Autriche, se déroule ainsi dans la maison de Jehan Hagomar, le 24 janvier 1491. Y sont invités le chancelier et « plusieurs gens d’estat, tant gens de conseil, cappitaines de la meson de la royne, nostre souveraine dame, que mesmes des officiers et bourgeoys de ladite ville ». Pour les bourgeois de Rennes, organiser un tel festin n’est d’ailleurs pas chose aisée puisque le duché est en guerre contre la France et que la ville est assiégée. D’autres banquets se tiennent dans des bâtiments publics, comme la maison de la garde-robe ducale à Rennes, ou encore dans des auberges réputées.
Les comptes des miseurs ne permettent malheureusement pas de connaître dans le détail l’organisation de ces banquets et l’on ignore ainsi tout du nombre des convives, des places données aux invités ou encre de l’ordre des plats servis. En revanche, ils permettent de reconstituer les menus, ceux-ci différant d’un banquet à un autre. Certains repas s’apparentent à de véritables festins où se succèdent une grande variété de mets. Ceux-ci sont souvent très riches en viande qui peut être bouillie, rôtie ou farcie, souvent servie avec des sauces. On trouve notamment des lapins, des chapons de Cornouaille, des perdrix, des bécasses, des pigeons, des poulets, parfois des tourterelles et des hérons. Le bétail est aussi à la fête, que ce soit du bœuf, du porc, sous forme de jambon ou de lard, du mouton ou du chevreau. Généralement, la viande est servie après les mises en bouche et le premier service qui se compose de potages. Loin du bouillon de légumes que nous connaissons aujourd’hui, il s’agit d’une sorte de ragoût de viandes salées comme les andouilles, boudins, saucisses. Le deuxième service est réservé aux rôtis de viande de bœuf, moutons, volailles, accompagnés de sauces. Enfin, au troisième service, est présentée la venaison, c’est-à-dire le gibier à poil.
En période de Carême, on sert plusieurs variétés de poissons de mer ou d’eau douce : « gounaux », merlans, « rayes », « gralies », « lammers », « bretmets », « becques », « becquets », « lamprayes », saumons, « morhous » (marsouins) et harengs blancs, le poisson des pauvres. Ces mets peuvent être accompagnés de sauces réalisées avec du chou et du cresson.
On utilise du pain, soit pour accompagner les mets, soit en guise d’assiette. Les aliments sont relevés par les condiments, du sel, du vinaigre et surtout des épices qui occupent une place importante malgré leur prix élevé : « pouldre jaune », « pouldre blanche », safran, cannelle, clous de girofle et autres « menues espices ». Elles sont en effet censées activer la digestion. Les épices servent à relever les sauces ou à la préparation de l’hypocras.
 L’entremet constitue, comme son nom l’indique, une pause entre les mets. C’est aussi le moment où l’on laisse entrer jongleurs, acteurs et musiciens. Au service d’entremets des tables bourgeoises, il arrive qu’on serve des plats simples, comme la fromentée, une bouillie de céréales parfois colorée au safran. Dans les banquets les plus somptueux, on y présente des pièces très spectaculaires, par exemple un paon recouvert de toutes ses plumes comme s’il était vivant.
L’entremet constitue, comme son nom l’indique, une pause entre les mets. C’est aussi le moment où l’on laisse entrer jongleurs, acteurs et musiciens. Au service d’entremets des tables bourgeoises, il arrive qu’on serve des plats simples, comme la fromentée, une bouillie de céréales parfois colorée au safran. Dans les banquets les plus somptueux, on y présente des pièces très spectaculaires, par exemple un paon recouvert de toutes ses plumes comme s’il était vivant.
Le dîner se termine par une note sucrée avec toutes sortes de pâtisseries parfumées, en particulier des tartes, des « mestiers », sortes de petits fours, ou encore des dragées blanches, colorées ou perlées qui composent « l’yssue ». Sur les tables figurent aussi des fruits selon la saison, des prunes, des cerises, des poires, des pommes et parfois des fruits méditerranéens, comme les figues ou les oranges. Souvent, les fruits frais sont servis au début du repas et les fruits cuits, secs ou confits en dessert.
L’hospitalité est une obligation régie par un rituel dont le banquet constitue le foyer principal. Le coût est extrêmement élevé pour celui qui reçoit. Mais l’enjeu en vaut la peine. En effet, les visiteurs, une fois de retour dans leur pays, rendent compte du traitement qui leur a été prodigué. Leur accueil fait donc partie intégrante de la propagande ducale et contribue au prestige du duché de Bretagne sur la scène européenne.