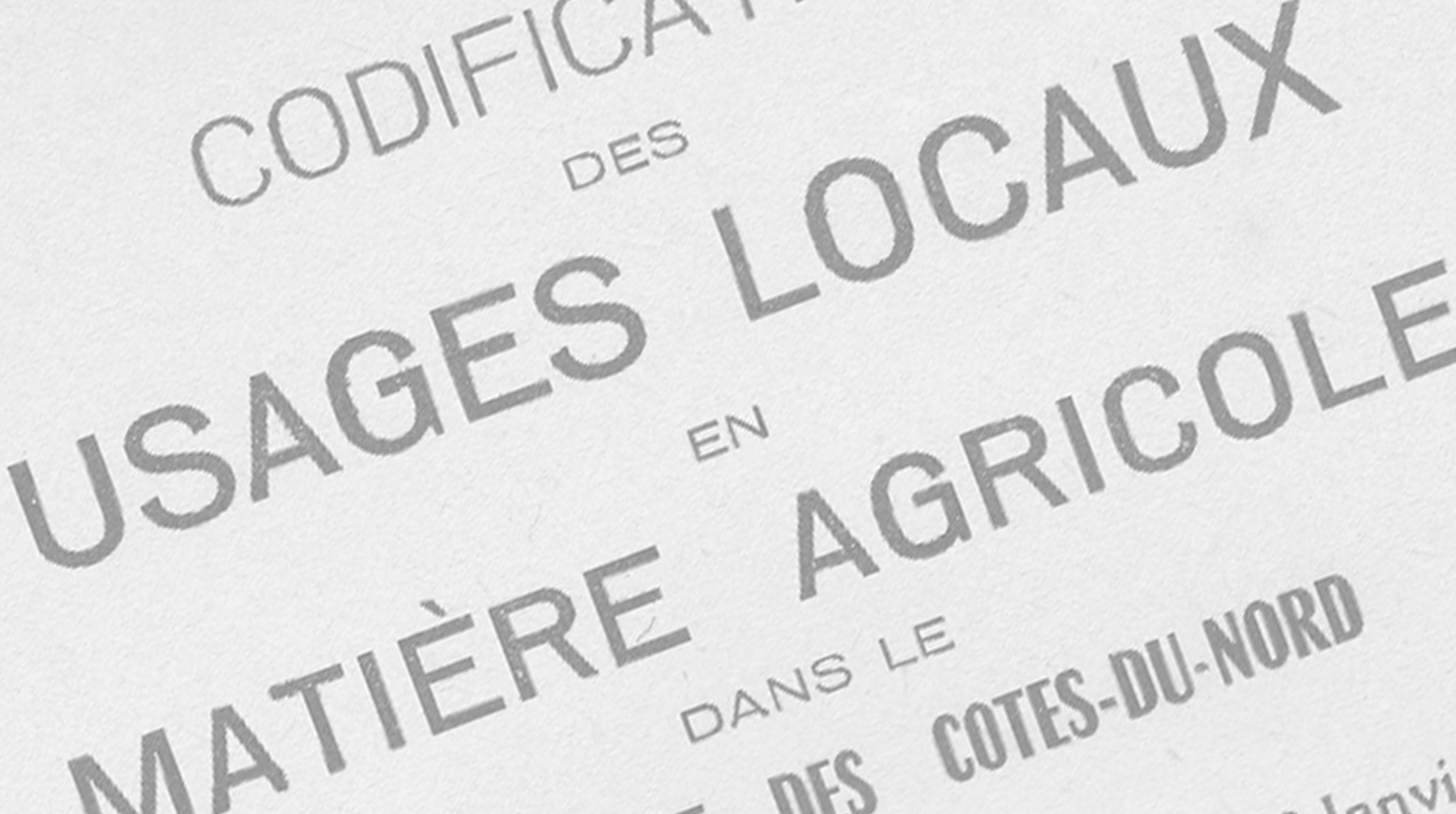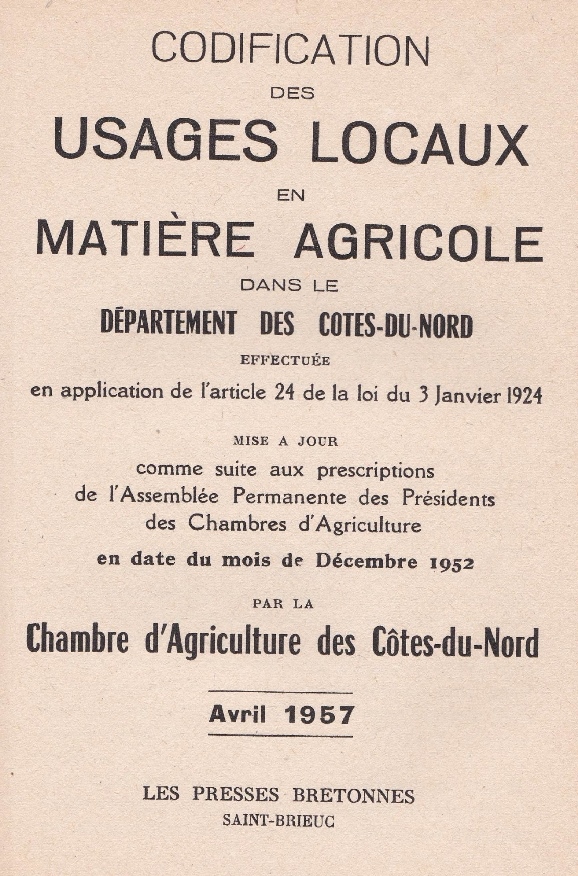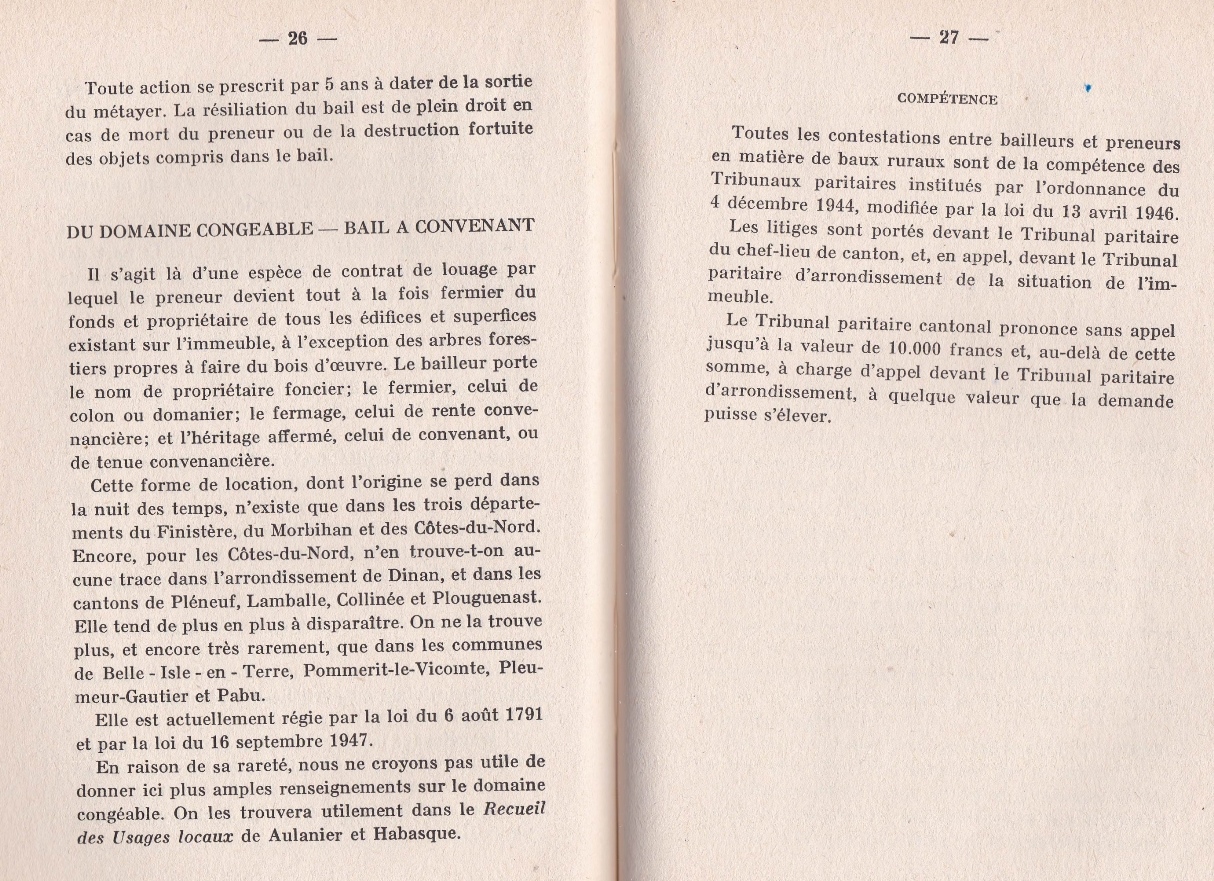La Révolution, puis le Code civil (1804) ont conservé au droit coutumier une place résiduelle : ce Code, ainsi que le Code rural renvoient en effet parfois aux « coutumes particulières ».
La Coutume générale de Bretagne a, par contre, cessé d’avoir force de loi dans les matières régies par le Code civil.
Les anciennes « usances urbaines » de Rennes et Nantes, ainsi que les « usements ruraux » du « domaine congéable » peuvent, eux, toujours être invoqués :
- Pour les servitudes applicables aux immeubles édifiés avant 1804 ou reconstruits à l’emplacement de bâtiments plus anciens. C’est en particulier le cas de la servitude du « tour d’échelle » : le propriétaire d’une maison située en limite de propriété a juridiquement le droit de passer sur le terrain voisin ne lui appartenant pas, pour réaliser des réparations. Il peut notamment y placer échelles et échafaudages, même si ce droit ne figure dans aucun acte notarié.
- Pour le détail des règles régissant le « domaine congéable », auquel le Nouveau Code rural consacre les articles L 431-1 à L 431-23 (1991), il s’agit d’un mode d’exploitation agricole remontant au Moyen Âge, initialement limité à la Basse-Bretagne. Il est basé sur la juxtaposition de différents propriétaires sur un même bien : l’un – le « colon » – a la propriété des « édifices et superfices » (bâtiments, récoltes et tout ce qui s’élève au-dessus du sol : talus, arbres fruitiers, puits et fontaines, pressoirs…) ; l’autre – le « propriétaire foncier » – a la propriété du « fonds » de la terre, et perçoit pour cela du colon une « rente convenancière » annuelle.
Un exemple de survivance du droit coutumier, le domaine congéable. Crédit : coll. Thierry Hamon.