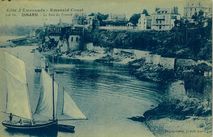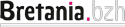Aujourd’hui, la chapelle de Locmaria se présente comme un édifice de plan rectangulaire orienté, d’environ 16 mètres par 9,50 mètres avec une nef centrale d’environ 5 mètres de largeur et deux collatéraux. Le mur pignon est supporte le clocher plat à deux baies en plein-cintre. Ce mur pignon est rythmé par 3 voûtes en arc brisé qui reprennent l’organisation interne de la chapelle et prouvent que l’édifice a été en partie tronqué. Ces éléments ont été comblés par des moellons de granit en réemploi (dont un bassin ou bénitier) : leur mise en œuvre est en effet nettement différente du reste de l’édifice. Entre la voûte de la nef et les collatéraux, on distingue encore les bases des piliers soutenant sans doute à l’origine les voûtes du chœur.
 Le pignon ouest apparaît, quant à lui, relativement homogène. Il est conforté par 2 contreforts en façade encadrant une porte à double battant surmontée d’une voussure constituée d’arcs brisés. Le tout est surmonté de deux rampants constitués d’éléments décoratifs sculptés en réemploi. L’assisage et la relative asymétrie du portail suggèrent un travail de qualité assez médiocre, probablement postérieur au programme architectural d’origine. Cette idée est confortée par la présence d’un œil-de-bœuf ovoïde surplombant le portail, qui ne correspond pas aux pratiques médiévales. Si l’on considère l’homogénéité de ce pignon et le coup de sabre dans les maçonneries à l’ouest du mur sud, on pourrait émettre l’hypothèse d’une reconstruction complète, à une époque indéterminée.
Le pignon ouest apparaît, quant à lui, relativement homogène. Il est conforté par 2 contreforts en façade encadrant une porte à double battant surmontée d’une voussure constituée d’arcs brisés. Le tout est surmonté de deux rampants constitués d’éléments décoratifs sculptés en réemploi. L’assisage et la relative asymétrie du portail suggèrent un travail de qualité assez médiocre, probablement postérieur au programme architectural d’origine. Cette idée est confortée par la présence d’un œil-de-bœuf ovoïde surplombant le portail, qui ne correspond pas aux pratiques médiévales. Si l’on considère l’homogénéité de ce pignon et le coup de sabre dans les maçonneries à l’ouest du mur sud, on pourrait émettre l’hypothèse d’une reconstruction complète, à une époque indéterminée.

Une chapelle du XIVe siècle et ses évolutions
La charpente que l’on observe en couvrement de la chapelle de Locmaria pourrait remonter à la seconde moitié du XIVe siècle, puisque nous en conservons des modèles similaires datés d’entre 1340 (Anjou) jusqu’aux environs de 1380-1400 en Bretagne. Cette charpente ne témoignant, au moins dans sa partie visible, d’aucun remaniement d’ampleur, il faut considérer les années 1340-1380 comme la date à partir de laquelle l’édifice actuel est construit. Cette hypothèse entre d’ailleurs en concordance avec la présence de la plate-tombe de Pierre de Broërec, nécessairement postérieure à 1340, date de sa mort. Cette datation est sans doute celle qu’il faut retenir pour la plupart des éléments architecturaux encore visibles. Force est de constater que les voûtes de la nef et son couvrement semblent relativement homogènes, à l’exception du lambrissage du charpentage, sans doute attribuable au XIXe siècle, comme c’est le cas la plupart du temps. La base de tous les piliers, comme les arcs brisés qui les surmontent, présentent des moulurations et des chanfreins tout à fait identiques.
La documentation historique fait état de multiples phases d’abandon. Ainsi, en 1699, l’évêque de Vannes, informé que « la chapelle de Locmaria en Ploemel estoit en ruine » demande à ce que le nécessaire soit fait pour pourvoir à sa réparation. Il n’est pas à exclure que le pignon ouest ait pu être reconstruit à cette époque. C’est en tout cas ce que pourrait suggérer son style architectural, mêlant des éléments de réemplois avec un œil-de-bœuf surmontant le portail. Par ailleurs, s’il est évident, au regard des élévations subsistantes et des sources en notre possession, que le chœur de l’église est détruit au XIXe siècle, le même procès-verbal de 1733 mentionne également une sacristie, dans laquelle le prêtre se rend en passant par la nef. On peut émettre l’hypothèse que celle-ci devait, comme c’est traditionnellement le cas, ouvrir sur le chœur et est détruite au même moment. La période révolutionnaire pourrait correspondre à une nouvelle phase d’abandon de la chapelle, au moins dans sa fonction cultuelle. En 1801-1802, celle-ci est décrite par l’administration comme étant de grande taille, capable d’accueillir 500 personnes, soit autant que l’église paroissiale. De surcroît, il est précisé que les vitres en étaient particulièrement dégradées. Pendant la Révolution, le bâtiment a servi de caserne et de corps de garde. Le chœur, ruiné, est quant à lui détruit entre 1820 et 1825.
Un ancien prieuré hospitalier
L’un des premiers indices de l’existence d’un hôpital à Locmaria est constitué par les matrices du cadastre napoléonien de 1845, qui recensent deux parcelles appelées Liorh En Hospital, c’est-à-dire, le « jardin de l’hôpital », situées immédiatement au sud de la chapelle. Les aveux que rendent les seigneurs de Trévégat de la seigneurie Locmaria auprès de la Chambre des Comptes de Bretagne en 1638 et en 1653 mentionnent une « thenue du Saint-Esprit », qui pourrait en partie correspondre aux parcelles Liorh En Hospital. Par ailleurs, un acte de 1709 indique que le seigneur de Locmaria doit verser une rente en céréales à la commanderie du Saint-Esprit d’Auray.
 Enfin, les actes de l’évêché de Vannes concernant Locmaria laissent place à une forte ambigüité en appelant l’édifice cultuel « chapelle ou prieuré », c’est-à-dire que l’on ne sait plus quelle était la destination originelle de l’édifice : s’agissait-il d’un lieu de culte secondaire dépendant d’une paroisse (chapelle) ou d’un petit établissement monastique dépendant d’une abbaye (prieuré) ? Cette ambigüité est levée à la lecture du procès-verbal dressé à l’occasion de l’installation du nouveau recteur de Locmaria, Vincent Lebreton, en 1733. En effet, celui-ci, après avoir réalisé tous les rites par lesquels il fait savoir à la population environnante qu’il prend possession de la chapelle, quitte l’édifice en compagnie de plusieurs témoins et « de là somme sortys de ladite chapelle et allés de compagnie jusques à une maison en ruinne que l’on nous a dit s’apeller anciennement la maison de l’hôpital dependante du prieuré dans le jardin au deriere à présent en labeur cerné de quelques vieux murs dans tous lesquels endroits nous avons mis et induit ledit sieur Lebreton en la réelle et actuelle pocession et jouïssance dudit prieuré et de ses dépendances, fruits et revenus que nous a dit consister en dixme à l’onzième sur toutes les terres dépendant de ladite terre de Locmaria ». Cette seule mention indique clairement qu’à Locmaria se trouvait un prieuré hospitalier, que l’on peut relier au Saint-Esprit d’Auray grâce aux textes précédemment mentionnés, et que la chapelle Notre-Dame-de-Pitié en était la chapelle priorale. Il faut dire que Locmaria, situé sur la route reliant Auray à Quiberon, devait constituer un endroit stratégique pour l’établissement d’un tel édifice.
Enfin, les actes de l’évêché de Vannes concernant Locmaria laissent place à une forte ambigüité en appelant l’édifice cultuel « chapelle ou prieuré », c’est-à-dire que l’on ne sait plus quelle était la destination originelle de l’édifice : s’agissait-il d’un lieu de culte secondaire dépendant d’une paroisse (chapelle) ou d’un petit établissement monastique dépendant d’une abbaye (prieuré) ? Cette ambigüité est levée à la lecture du procès-verbal dressé à l’occasion de l’installation du nouveau recteur de Locmaria, Vincent Lebreton, en 1733. En effet, celui-ci, après avoir réalisé tous les rites par lesquels il fait savoir à la population environnante qu’il prend possession de la chapelle, quitte l’édifice en compagnie de plusieurs témoins et « de là somme sortys de ladite chapelle et allés de compagnie jusques à une maison en ruinne que l’on nous a dit s’apeller anciennement la maison de l’hôpital dependante du prieuré dans le jardin au deriere à présent en labeur cerné de quelques vieux murs dans tous lesquels endroits nous avons mis et induit ledit sieur Lebreton en la réelle et actuelle pocession et jouïssance dudit prieuré et de ses dépendances, fruits et revenus que nous a dit consister en dixme à l’onzième sur toutes les terres dépendant de ladite terre de Locmaria ». Cette seule mention indique clairement qu’à Locmaria se trouvait un prieuré hospitalier, que l’on peut relier au Saint-Esprit d’Auray grâce aux textes précédemment mentionnés, et que la chapelle Notre-Dame-de-Pitié en était la chapelle priorale. Il faut dire que Locmaria, situé sur la route reliant Auray à Quiberon, devait constituer un endroit stratégique pour l’établissement d’un tel édifice.