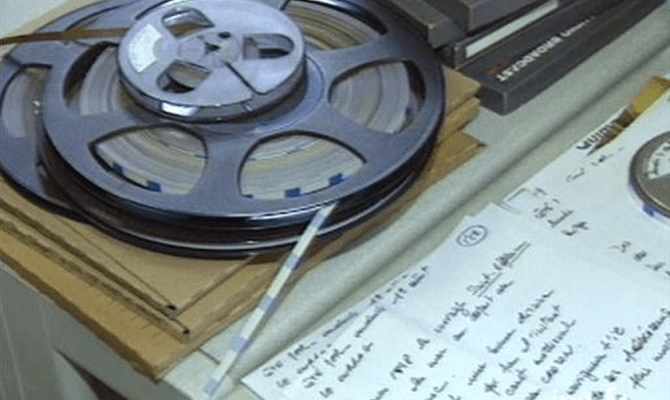Depuis quelques mois, il est possible d’entendre des annonces sonores en breton et en gallo à bord de trains régionaux BreizhGo. Une manière pour les voyageurs et voyageuses de se familiariser avec ces deux langues, reconnues « langues de Bretagne » en 2004. C’est aussi une belle occasion de les entendre pour les personnes qui les parlent au quotidien. Et elles sont encore nombreuses dans notre région : d’après une enquête publiée en janvier dernier, on estime que 107 000 personnes parlent le breton et 132 000 le gallo. Si le nombre de locuteurs est en baisse, l’étude annonce aussi une bonne nouvelle : les personnes qui parlent le breton et le gallo sont plus jeunes qu’auparavant et les pratiquent plus fréquemment. Il n’en reste pas moins que ces deux langues sont identifiées comme « sérieusement en danger » par l’Unesco.
Des origines différentes, un destin partagé
Voici donc, non pas une, mais deux langues pour une petite péninsule. Elles n’appartiennent pas à la même famille : le breton est une langue celtique, comme le gallois ou l’irlandais. Le gallo appartient quant à lui à la famille des langues romanes, plus précisément des langues d’oïl, comme le normand ou le picard. Il est parlé en majorité en Haute-Bretagne, à l’Est ; quand le breton est parlé surtout à l’Ouest, en Basse-Bretagne. La frontière linguistique, qui sépare ces deux aires, s’étend globalement de Saint-Brieuc à Vannes. Elle a évolué au fil des siècles. En effet, des populations de langue brittonique (celtique), arrivées d’outre-Manche, ont progressé jusqu’aux portes de Rennes et de Nantes aux alentours du IXe siècle, avant de refluer vers l’ouest lors des siècles suivants. Cette ligne de démarcation est aujourd’hui moins prégnante qu’autrefois. Malgré leurs origines distinctes, le breton et le gallo ont connu un destin commun, en particulier à l’école. Après la Révolution française, l’enseignement a dû être dispensé en français. Et même si l’usage des langues régionales à l’école n’était pas interdit, ce sont les règlements scolaires qui excluaient alors progressivement l’usage du breton et du gallo sur la cour de récréation et en classe. De plus, le large processus de dévalorisation des cultures populaires rurales, renforcé par la modernisation agricole de l’après-guerre, a accentué ce recul au XXe siècle. Les chiffres sont frappants : avant le premier conflit mondial, plus d’un million de personnes parlaient le breton au quotidien, et la plupart ne parlaient que cette langue !
Gallo et breton, deux langues voisines
Le gallo et le breton ne se tournent pas le dos, bien au contraire : ces deux langues n’hésitent pas à se faire des emprunts ! Le terme « gallo » vient d’ailleurs du breton gall, désignant l’étranger, celui qui ne parle pas la langue bretonne. Quant au verbe huchal (crier, en breton), c’est l’inverse : il vient du gallo hucher. Par ailleurs, dans le pays de Guérande, les gallésants ont emprunté aux bretonnants un outil bien pratique : la karigell (brouette, en breton), qui s’est transformé en cariqhelle en gallo, qui est une petite charrette. De plus, certains mots du gaulois, parlé auparavant dans la péninsule armoricaine, ont imprégné les deux langues, comme kuzhat et qhuter qui signifient tous deux « cacher ». Aujourd’hui, avec 20 000 enfants scolarisés en breton, des formations en gallo tous azimuts, mais aussi la mise en place des chartes « Ya d’ar brezhoneg » (« Oui à la langue bretonne ») et « Du Galo, Dam Yan Dam Vèr » (« Du gallo, oui bien sûr ! »), de nombreuses communes, associations et entreprises agissent pour la promotion de ces langues, par exemple en encourageant l’affichage de la toponymie locale. Petites par leur nombre, mais sacrément résistantes, nos langues de Bretagne !