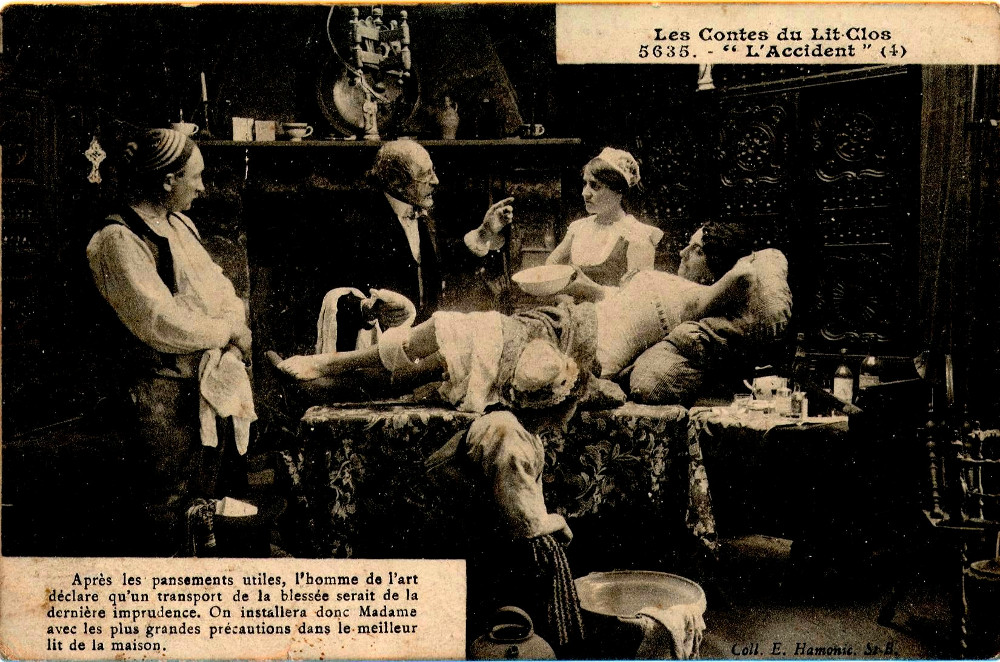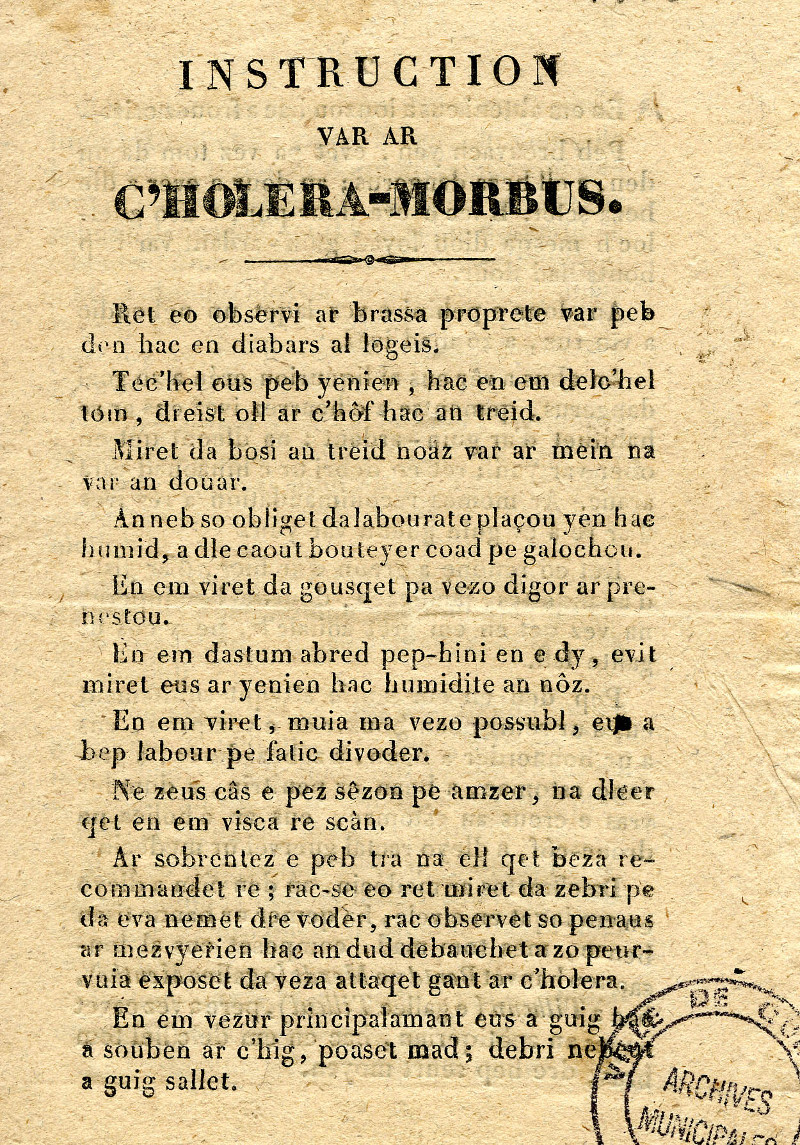Le poids des déterminants de santé
C’est moins le difficile accès aux soins que les conditions d’existence (pénibilité du travail, insalubrité de l’habitat, alimentation mal équilibrée, hygiène déficiente) qui expliquent la morbidité et la mortalité au début de la Troisième République. Si les bouffées épidémiques sont circonscrites localement, tel le choléra à Lorient et ses alentours en 1892 (231 morts), les maladies transmissibles restent des causes majeures de décès : la variole sévit toujours dans le Morbihan (1 770 morts en 1889) malgré la vaccine ; la typhoïde et la diphtérie touchent régulièrement les villes (quelque 900 décès cumulés à Nantes vers 1880).

Une offre de soins longtemps insuffisante
Malgré un quadruplement de leur nombre en soixante-dix ans, les médecins demeurent, en 1965, toujours moins nombreux en Bretagne qu’en moyenne en France (8,4 médecins pour 10 000 habitants contre 11,7). De plus, ils se concentrent dans les villes principales. Dans le Morbihan, l’un des départements les moins médicalisés du pays, 40 % d’entre eux exercent à Vannes et Lorient en 1954. Avec la régionalisation de la formation (facultés de médecine à Rennes et Nantes puis à Brest), les installations se multiplient et un rééquilibrage s’opère progressivement : en 2000, 97 % de la population réside à moins de 5 km d’un généraliste.
La situation était également délicate pour les établissements de santé alors que la population hésitait moins à se faire hospitaliser après 1945 (70 % des costarmoricaines accouchent à l’hôpital ou en clinique en 1960). Parce que beaucoup d’établissements n’étaient plus aux normes, il fallait les moderniser (plateaux techniques) et améliorer leur accueil. Un soutien financier de l’État était nécessaire ; la Bretagne en profitera dans les années 1960 et surtout 1970 (plan médico-hospitalier).
La région va ainsi peu à peu combler son retard : en 2012, la densité de professionnels de santé de premiers recours y est comparable à la moyenne, l’activité hospitalière légèrement moindre et le taux d’équipement en établissements médicosociaux supérieur. Mais de nouvelles tensions se font jour : non-remplacement de généralistes dans les zones moins attractives ; déficit croissant de certaines spécialités. En outre, les progrès observés ne concernent pas à l’identique tous les territoires, ni toutes les catégories sociales. Les écarts infrarégionaux (entre l’Est et l’Ouest, le littoral et l’intérieur) sont aussi importants que les écarts entre la région et la moyenne nationale.
La santé, affaire régionale
Longtemps, les actions sanitaires et sociales sont restées de la compétence quasi exclusive des collectivités locales, municipalités (hôpitaux et hospices, bureaux de bienfaisance) et départements (asiles d’aliénés, enfance assistée). L’implication des élus était donc essentielle. Le rôle du conseil général fut ainsi déterminant pour faire du Finistère un département pilote en matière de lutte contre la tuberculose dans l’entre-deux-guerres.
Cette situation était décriée par les hygiénistes qui, dès le XIXe siècle, souhaitaient une régulation plus forte du pouvoir central. Si celle-ci se précise petit à petit, il faut attendre les années 1970 pour que la santé devienne pleinement l’affaire de l’État. La répartition des compétences au moment de la décentralisation en résulte : la santé à l’État ; le social aux collectivités territoriales. Parallèlement, s’affirme le rôle de décision et d’impulsion de l’échelon régional (réforme de l’administration des affaires sociales en 1977), un rôle conforté depuis par la création des agences régionales de santé (2010). Mais pour agir sur les déterminants de santé et réduire les inégalités infrarégionales, il faut concilier les besoins du terrain et les politiques nationales : c’est là un défi pour les instances de la démocratie sanitaire (conférences régionales et des territoires) et les collectivités locales (villes OMS, animation territoriale de santé soutenue par la Région).